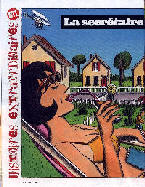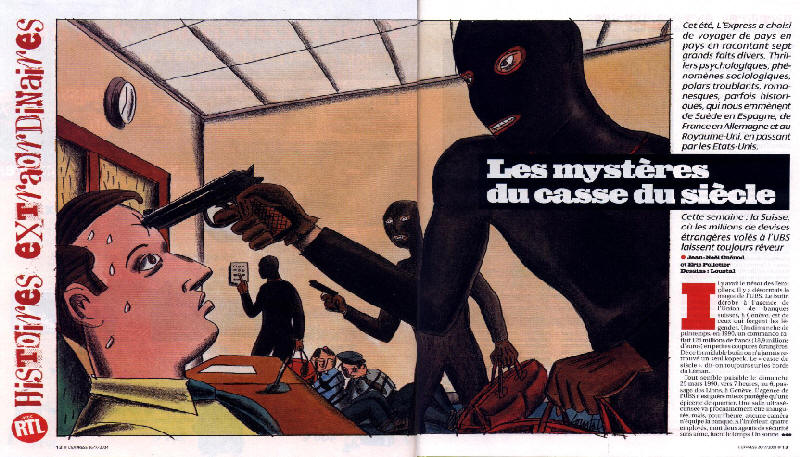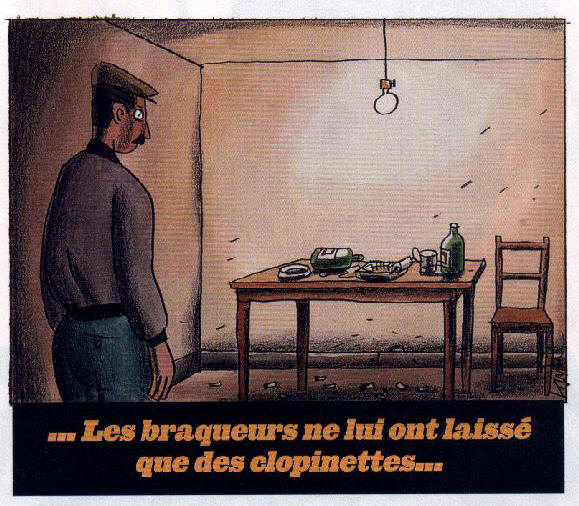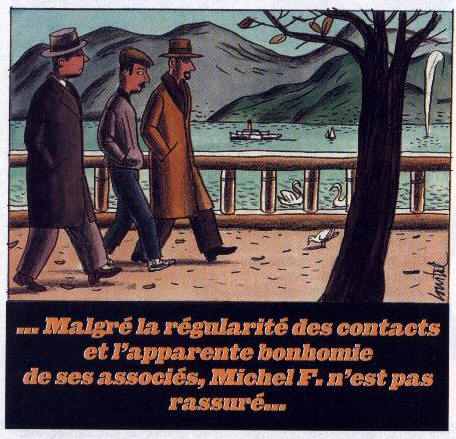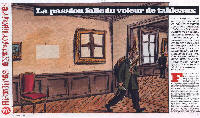|
 
2004
L'Express n°2769 semaine du 26 juillet au 1er août 2004.

|
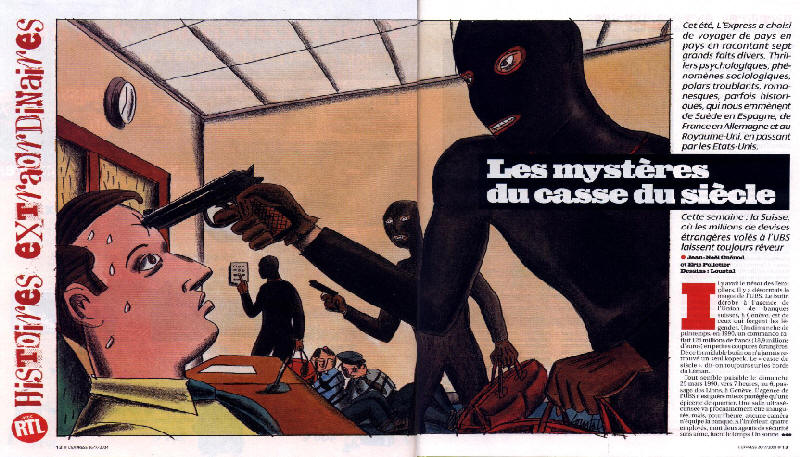
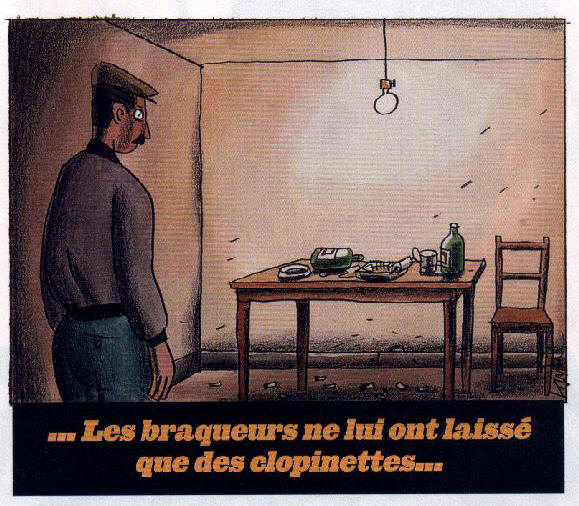 |
 |
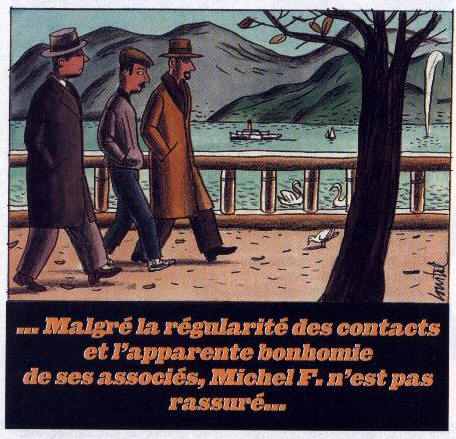 |
 |
 |
 |
|
|
|
L'Express du 26/07/2004
Histoires extraordinaires
Les mystères du casse du siècle
par Jean-Noël Cuénod, Eric Pelletier
Cet été, L'Express a choisi de voyager de pays en
pays en racontant sept grands faits divers.
Thrillers psychologiques, phénomènes sociologiques,
polars troublants, romanesques, parfois historiques,
qui nous emmènent de Suède en Espagne, de France en
Allemagne et au Royaume-Uni, en passant par les
Etats-Unis. Cette semaine: la Suisse, où les
millions de devises étrangères volés à l'UBS
laissent toujours rêveur
Il y avait le trésor des Templiers. Il y a désormais
le magot de l'UBS. Le butin dérobé à l'agence de
l'Union de banques suisses, à Genève, est de ceux
qui forgent les légendes. Un dimanche de printemps,
en 1990, un commando raflait 124 millions de francs
(18,9 millions d'euros) en petites coupures
étrangères. De ce formidable butin on n'a jamais
retrouvé un seul kopeck. Le «casse du siècle»,
dit-on toujours sur les bords du Léman.
Tout semble paisible le dimanche 25 mars 1990, vers
7 heures, au 6, passage des Lions, à Genève.
L'agence de l'UBS n'est guère mieux protégée qu'une
épicerie de quartier. Une salle ultrasécurisée va
prochainement être inaugurée, mais, pour l'heure,
aucune caméra n'équipe la banque. A l'intérieur,
quatre employés, dont deux agents de sécurité sans
arme, tuent le temps. On sonne au vieil Interphone.
«Lorsque j'ai vu le premier homme sauter le
portillon, j'ai d'abord pensé à une plaisanterie,
avoue l'un des vigiles, Patrick. A ce moment, l'idée
d'une agression ne m'a pas effleuré. En revanche,
j'ai compris de quoi il s'agissait lorsqu'un des
brigands m'a mis son revolver sur le ventre.» Au
total, cinq hommes, armés, gantés, grimés,
investissent les lieux. Ils frappent les vigiles à
coups de crosse avant de les ligoter avec l'employé
qui est en train de mettre les horloges à l'heure
d'été. Les gangsters neutralisent les alarmes. Ils
sont étonnamment bien renseignés: ils connaissent
les combinaisons chiffrées nécessaires à l'ouverture
de coffres de la salle des monnaies étrangères. Ils
jettent dans de grands sacs de sport des dollars
américains, des francs français et, surtout, une
importante quantité de dirhams marocains qui
viennent d'être livrés... En l'espace d'une heure
trois quarts, montre suisse en main, ils raflent au
total près de 220 kilos de billets! Ils traversent
ensuite la ville endormie, dans une Renault Espace
et une petite voiture de couleur sombre,
immatriculées en Haute-Savoie. Jamais une telle
somme n'avait été dérobée sur les bords du lac
Léman. Et la seule empreinte relevée est celle du
premier policier arrivé sur les lieux! Ce matin-là,
le tableau de service de la PJ de Genève veut que
l'inspecteur principal Marco Mattille soit de
permanence. L'homme prend aussitôt l'affaire en
main. Ce flic réputé cache une finesse de renard
dans un corps de dogue allemand. Mattille flaire
rapidement des complicités internes. Son intuition
ne le trompe pas...
«Les braqueurs ne lui ont laissé que des
clopinettes»
Le 25 mars 1990 au soir, à Genève, un homme dévore
des yeux les informations télévisées. Michel F.
esquisse un sourire sous sa moustache lorsque les
journalistes évoquent le «casse du siècle». Sans
lui, prof de gym franco-genevois dans un club
sportif chic, au physique passe-partout, ce coup de
maître était impossible. F. a obtenu d'un employé de
l'UBS le plan de l'agence et le code de certains
coffres, qu'il a remis, la veille du coup, à des
membres du commando. Il faut dire que le prof de gym
qui, à ses heures perdues, passe des valises de
billets de France en Suisse, a ses entrées à l'UBS:
il a épousé l'assistante personnelle du chef du
service des monnaies étrangères. Grâce à sa femme,
il passe d'ailleurs des vacances au ski avec le
banquier. La nuit est tombée. Michel F. enfile une
petite laine et sort de chez lui pour retrouver les
voyous dans leur planque. Il les a rencontrés à
plusieurs reprises par le biais d'un intermédiaire,
mais, par mesure de sécurité, il ignore leurs noms.
Lorsqu'il arrive à l'appartement, au 47, quai du
Rhône, il ne trouve qu'une vingtaine de mégots qui
jonchent le sol. Les braqueurs lui ont laissé des
clopinettes. Cocufié, le prof de gym entre dans une
rage folle: «Même dans les plus mauvais films,
l'histoire ne se termine pas comme ça!» éructe-t-il.
Il se lance sur la piste encore chaude des truands.
Le cave se rebiffe.
Michel F. commence par exiger des explications
auprès de l'intermédiaire qui lui a présenté les
membres de l'équipe. A l'époque, sur le conseil d'un
avocat niçois, ceux-ci cherchaient seulement à
rencontrer un banquier suisse pour placer leur
argent. Cet industriel lyonnais, qui fond des
lingots d'argent pour l'UBS, affirme donc ne rien
savoir du vol. Il lui conseille de s'adresser à
l'avocat niçois présenté comme le «défenseur des
braqueurs». Michel F. joue décidément de malchance.
La récompense promise par la banque (10% du montant
du butin) commence en effet à aiguiser les appétits.
Aussitôt la conversation terminée, l'industriel
dénonce Michel F. à l'UBS. Le prof de gym, qui ne se
doute pas qu'il vient d'être «balancé», file sur la
Côte d'Azur, au cabinet de l'avocat niçois. Et se
métamorphose en espion: il cache un magnétophone
dans sa poche. A deux reprises, le 26 avril, puis le
4 mai 1990, il enregistre ses conversations avec
l'homme de loi. C'est ainsi qu'il obtient une piste
qui conduit tout droit à Bastia. Michel F. va se
frotter, sans s'en douter, à la «Brise de mer»,
comme les policiers ont surnommé l'équipe corse la
plus influente de ces années-là.
Il envoie à Bastia son beau-frère et un ami. Pendant
trois jours, du 9 au 11 mai 1990, les apprentis
détectives prennent en filature deux gros bonnets du
banditisme. Le premier, cheveux gominés et souliers
vernis, s'appelle André Benedetti, «Dédé» pour les
intimes, «Dédé le Chinois» pour les journalistes.
Cet enfant de la Coloniale doit son surnom à sa
naissance, un jour de septembre 1936, dans la
concession française de Tianjin, en Chine du Nord,
où son père était militaire. Ancien braqueur,
Benedetti s'est reconverti dans le commerce,
l'immobilier et la restauration. La grande affaire
de sa vie, en dehors de l'éducation de ses trois
filles, reste la peinture: il expose dans une
galerie bastiaise. A cette époque, l'homme se remet
doucement d'une longue douleur: un redressement
fiscal. L'autre cible des Sherlock suisses se nomme
Jacques Patacchini. Le grand Jacques, personnage
entier au verbe aussi haut que ses pommettes, a vu
le jour sous le signe de l'eau. Originaire de la
région d'Orezza, célèbre pour sa source gazeuse, cet
ancien mousse de la marine marchande dirige
aujourd'hui un chantier naval à Bastia, juste sous
les fenêtres du commissariat. C'est un homme libre
qui chérit l'Océan. «J'ai toujours cherché à me
rapprocher de la mer, lance-t-il. Certains diront:
de la Brise de mer.»
En ce printemps de 1990, loin de la Méditerranée, à
Genève, Michel F. continue à s'agiter et à collecter
les renseignements. L'inspecteur Marco Mattille
l'observe, l'écoute, le jauge. Le flic ne veut pas
perdre le fil qui le relie aux braqueurs. Le 29 mai
1990, le prof de gym est finalement arrêté dans une
cabine téléphonique, alors qu'il enregistre une
énième conversation. Face aux policiers, F.
reconnaît rapidement son rôle. Il se livre même avec
un évident soulagement, pas fâché de régler ses
comptes. Sur son témoignage repose une grande part
de l'accusation.
Que dit au juste Michel F.? En novembre 1989, alors
que le monde regarde s'écrouler le mur de Berlin, F.
convoie des valises de billets de France en Suisse.
On lui demande de contacter l'UBS pour le compte
d'un Corse, un certain Dédé Benedetti, qui cherche à
placer l'équivalent de 5 millions de francs en lires
italiennes. La banque décline l'offre, l'argent
sentant décidément trop la marée. Faut-il y voir le
sursaut d'un orgueil froissé? C'est en tout cas à ce
moment que serait née l'idée du hold-up. Au début de
l'année 1990, toujours selon F., cinq réunions se
tiennent, tantôt à Genève, tantôt à la gare
d'Annecy, avec plusieurs braqueurs corses. Malgré la
régularité des contacts et l'apparente bonhomie de
ses «associés», Michel F. n'est pas rassuré. Un jour
de février ou de mars 1990, il demande même à l'un
de ses amis de le photographier discrètement alors
qu'il se trouve en leur compagnie. Le prof de gym
veut garder une preuve si, d'aventure, il finissait
au fond du Léman... L'image, prise au téléobjectif
par un bel après-midi d'hiver, est bien réussie. On
y voit F. déambuler en plein soleil dans une rue du
centre-ville de Genève, à deux pas de l'agence de
l'UBS, en compagnie de Jacques Patacchini et d'une
autre pointure (taille 44 Magnum) de la Brise de
mer, son ami Alexandre Chevrière. Dans ses
déclarations, F. donne aussi le nom de deux des
vigiles de la banque, censés être les complices du
commando.
«Malgré la régularité des contacts et l'apparente
bonhomie de ses associés, Michel F. n'est pas
rassuré»
Avec ces aveux, la police helvétique boucle
rapidement son volet de l'enquête. Le 13 mai 1992,
deux ans seulement après le casse du siècle, le prof
de gym ainsi que deux vigiles de l'UBS sont
condamnés à sept ans et demi d'emprisonnement pour
«brigandage aggravé». Seul l'un d'eux, Sebastiano
Hoyos, clame son innocence. Le parcours de cet homme
de 55 ans mérite qu'on s'y arrête un instant. Il
n'est guère courant, en effet, que des
révolutionnaires sud-américains refassent leur vie
dans des banques suisses. En 1962, le jeune
syndicaliste marxiste fuit le Brésil pour gagner la
Guyane française, où il se fait remarquer en animant
le mouvement indépendantiste. Dix ans plus tard, la
DST l'assigne à résidence à Mouchard (sic), dans le
Jura français. Pas pour longtemps. Hoyos prend le
maquis et se réfugie en zone neutre, à Genève, avec
femme et enfants. Pour gagner sa vie, le guérillero,
qui, entre-temps, a obtenu l'asile politique, se
fait embaucher comme gardien de sécurité à l'UBS.
Après sa condamnation pour complicité dans le
braquage de l'agence, un comité de soutien milite
pour sa réhabilitation. Hoyos introduit un recours
devant le Tribunal fédéral, l'équivalent de la Cour
de cassation française. C'est un homme au corps
noueux, tourmenté, mais solide comme un sarment que
les jurés suisses acquittent finalement sous les
vivats de ses supporters en 1996. La page suisse de
l'affaire est définitivement tournée.
La piste française s'avère nettement plus chaotique.
Les policiers de l'Office central pour la répression
du banditisme (OCRB) tentent de remonter, contre le
vent, la piste de la Brise. Un vaste coup de filet
est lancé les 15 et 16 janvier 1991. L'inspecteur
Mattille et son adjoint font, pour l'occasion, le
voyage de Genève à Bastia. Leur venue ne passe pas
inaperçue. Dans un bar voisin, un inspecteur
bastiais lance même à la cantonade: «Un pastis pour
ces messieurs de la police suisse!» «Le matin de
l'interpellation, se souvient Mattille, un papy en
marcel nous attendait, sur un chemin de terre: «Ah!
Je vous cherchais! nous a-t-il lancé. Les Patacchini
sont partis. Restez pas là: je vous ai préparé le
café à la maison!»» André Benedetti a préféré, lui
aussi, prendre un peu de «recul». Après une courte
cavale, il rentre dans son appartement bastiais, où
il s'aménage une planque dans un meuble qui sert
habituellement à abriter la machine à laver. Il y a
installé deux loquets, qu'il tire de l'intérieur en
cas d'alerte. Mais, en septembre 1991, l'OCRB finit
par le débusquer dans sa cache. Jacques Patacchini
est, lui, arrêté dans une galerie marchande de
Saint-Laurent-du-Var, le 13 janvier 1992, alors
qu'il achète des jumelles. Son frère Joël, puis
Alexandre Chevrière, l'autre homme figurant sur la
photo prise à Genève, tombent à leur tour. Mais,
coup de théâtre, pour la journée du casse, ce
dernier fournit un alibi en apparence imparable:
Chevrière se souvient d'avoir été contrôlé, le 25
mars 1990, vers 9 heures du matin, dans un bar de
Marseille. La vérification est aisée, puisque la
«preuve», le procès-verbal d'intervention, dort dans
les archives de «l'Evêché», le quartier général de
la police à Marseille. Mais en l'examinant les
enquêteurs se rendent compte qu'il s'agit d'un faux,
rédigé par un complice!
Des galéjades, le dossier en connaîtra bien
d'autres. Prenez la cavale de Richard Casanova, dit
«Charles», présenté par l'accusation comme la
cheville ouvrière du commando. L'homme, qui a fêté
ses 45 ans le 3 juillet 2004, n'a jamais été
retrouvé. En 2001, on a presque failli l'oublier
judiciairement: pendant quelques mois, son nom a
mystérieusement disparu du fichier des personnes
recherchées pour l'affaire de l'UBS. Et, si le
patronyme de Casanova s'est perdu dans les méandres
judiciaires, l'affaire de l'UBS a bien failli
sombrer tout entière. Il aura ainsi fallu attendre
plus de quatorze ans pour que les quatre Français
soient jugés devant la cour d'assises de Paris. Le
dossier avait été renvoyé, une première fois, devant
un jury, en mai 2001, mais les avocats des accusés,
notamment les pugnaces Mes Thierry Herzog, Pierre
Haïk et Jean-Yves Liénard, ont fait justement
remarquer que leurs clients n'avaient jamais été
confrontés à leurs principaux accusateurs...
«Après une courte cavale, il rentre dans son
appartement bastiais, où il s'aménage une planque»
Le 7 juin dernier, trois bons pères de famille,
impliqués dans l'action humanitaire ou responsables
de clubs de football, se présentent libres devant la
cour d'assises de Paris. Seul Chevrière est encore
détenu. Pendant toute l'instruction, ils ont
protesté de leur innocence. Benedetti, qui depuis sa
sortie de prison, pour Noël 1993, a toujours
strictement respecté son contrôle judiciaire, veut à
la rigueur endosser l'habit du fraudeur, mais pas la
combinaison du braqueur. D'ailleurs, le jour du
hold-up, il se trouvait à Bastia. Jacques Patacchini
rappelle qu'il s'est rendu à la frontière suisse, au
début de l'année 1990, pour acheter des meubles (ce
que des investigations ont confirmé) et qu'il
recherchait, par la même occasion, un prêt bancaire
avantageux. Son frère Joël sous-entend qu'il
appréciait le sens de l'hospitalité des escort girls
genevoises. Chevrière, lui, accompagnait ses amis
pour se changer les idées tant il est monotone de
vendre des jeans contrefaits sur les marchés à
Marseille. Leurs avocats font remarquer qu'ils sont
descendus sous leur véritable identité à Genève,
qu'on n'a pas retrouvé leur ADN sur les mégots de la
planque, alors qu'ils fument «comme des
locomotives», qu'aucun centime suspect n'a alimenté
leur patrimoine, qu'ils ont fui parce qu'injustement
accusés et, enfin, que les témoins varient dans
leurs déclarations...
Les témoins, justement. Ils étaient la clef du
procès et on ne les voit guère. Michel F. a décliné
l'invitation et - par peur, volonté de tourner la
page ou les deux - il refuse d'en dire plus.
«Traumatisé», le vigile condamné ne vient pas non
plus. L'homme d'affaires lyonnais qui a dénoncé F.
est mort (de mort naturelle) il y a près de deux
ans. Quant à l'avocat niçois qui a servi
d'intermédiaire, il est soupçonné d'avoir empoché
une partie de la récompense de la banque. Rien
d'étonnant à ce qu'il manque de trépasser à chaque
convocation judiciaire. Cette fois, le malaise
cardiaque l'a rattrapé in extremis à Vintimille, la
veille de l'ouverture du procès. L'avocat général,
Philippe Bilger, tour à tour aimable et grinçant,
tempête contre ces pieds de nez à la justice, «cette
litanie d'absences et d'excuses». Quant aux témoins
qui acceptent de venir, ils tremblent de peur d'en
dire trop ou trop peu. L'un d'eux reconnaît même
avoir été approché par l'un des membres de la Brise.
Le verdict, lui, tombe nuitamment, à 2 heures du
matin, le 12 juin dernier: les quatre accusés sont
acquittés (1). «Je ne réalise pas encore. Ces années
de procédure, c'est comme un long cancer, confie
Jacques Patacchini à L'Express. J'ai hésité à faire
confiance à la justice. Au début, j'ai même cru
qu'il s'agissait d'un procès truqué.»
(1) Chevrière a aussitôt été libéré. Deux jours plus
tard, il était grièvement blessé dans un guet-apens
à Mimet (Bouches-du-Rhône).
La semaine prochaine: Le cauchemar de Dolorès
Vazquez
|
|
|